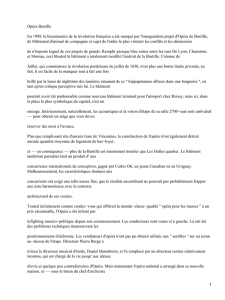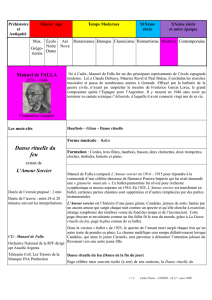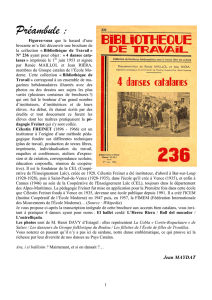N° 213 Par Danielle PISTER CERCLE LYRIQUE DE METZ 2013
Anuncio

2013-2014 CERCLE LY RIQ UE D E METZ Lakmé de Léo Delibes N° 213 Par Danielle PISTER Léo Délibes Léo Delibes Lakmé 1883 par Danielle Pister 1 2 SOMMAIRE Un musicien éclectique p. 05 Un rêve d’Orient p. 10 Un reflet du temps p. 15 Parole et musique p. 20 Création et réception p. 24 À lire p. 28 À écouter et À voir p. 28 3 4 Lakmé Et pourtant on aime de toute son âme cette âme qui vous échappe. Pierre Loti, Rarahu, Le Mariage de Loti (1880) Léo Delibes est reconnu internationalement pour la composition de deux ballets, Coppélia et Sylvia. Ses œuvres lyriques légères sont totalement sorties aujourd’hui du répertoire. Quant à Lakmé, même si cette œuvre n’a jamais été totalement délaissée en France, sa réputation concerne avant tout les pays francophones où elle se fit rare à partir des années 1970. Cet opéra semble retrouver un regain d’intérêt auprès des théâtres hexagonaux, mais aussi étrangers, en ce début de XXIème siècle. UN MUSICIEN ÉCLECTIQUE Formation Clément Philibert Léo Delibes, dit Léo Delibes, naît à Saint-Germain-duVal (agglomération de La Flèche dans la Sarthe) le 21 février 1836 (soit deux ans avant Georges Bizet) . Son père postier meurt alors qu’il n’a que onze ans et sa mère, fille de Jean Batiste, chanteur de l’Opéra-Comique et compositeur, s’installe alors à Paris. Elle-même fine musicienne, bien que non professionnelle, prend en charge l’éducation musicale de son fils avec l’aide de son propre frère, Édouard Batiste, organiste à Saint-Eustache, professeur de chant au Conservatoire et compositeur. L’enfant commence par étudier le chant en participant à diverses chorales. Ce n’est qu’ensuite, à presque douze ans en 1847, qu’il intègre le Conservatoire de Paris où il aborde le piano, l’harmonium et l’orgue. En 1850, à la deuxième tentative, il obtient un premier prix de solfège, et suit les cours de composition d’Adolphe Adam. Ce dernier doit sa célébrité aux succès, en 1836, de son opéra-comique Le Postillon de Longjumeau et, en 1841, de son ballet Giselle. Il est un des premiers à 5 introduire la pratique, encore discrète, du leitmotiv. Chez lui, la musique de ballet n’est plus un simple prétexte de rythmes à danser. Elle fait partie intégrante de l’histoire racontée dont elle crée l’atmosphère. Son élève saura s’en souvenir. Notons que le maître et son disciple auront une destinée semblable : tous deux se consacrèrent à l’opérette, à l’opéracomique et à l’opéra, mais la gloire leur vint du ballet. À l’issue d’un parcours sans grand relief au Conservatoire, par manque d’ambition ou parce qu’il ne croit pas en ses chances, Delibes ne tente pas le concours du Prix de Rome que la plupart de ses condisciples rêvent d’obtenir. Il devient, en 1853, organiste à Saint-Pierre-de-Chaillot et complète ses revenus en donnant des leçons de piano. Les débuts lyriques Le jeune Léo, choriste à l’église de la Madeleine, avait participé au chœur des garçons lors de la création du Prophète de Meyerbeer à l’Opéra de Paris, en 1849. Son intérêt pour l’art lyrique est encouragé par le poste de répétiteur obtenu au Théâtre-Lyrique, pour ses compétences pianistiques et grâce à l’appui d’Adolphe Adam. Il commence à composer des opérettes et des opéras-comiques au sortir du Conservatoire. Comme le Théâtre-Lyrique est installé boulevard du Temple, surnommé alors « boulevard du Crime », lieu où le mélodrame, la comédie d’intrigue et l’opérette tiennent le haut de l’affiche, il entre en contact avec un confrère, organiste à l’église Saint-Roch : Louis-AugusteFlorimond Ronger, dit Hervé. Ce dernier arrondit ses fins de mois le soir, comme pianiste et comme comédien. Il a ouvert un café-concert en 1854, les « Folies-Nouvelles » où il joue ses propres œuvres totalement extravagantes. Il produit, et interprète également, les premières pièces d’Offenbach. En 1856, Hervé donne sa première chance au compositeur Delibes en créant, dans son établissement, sa première opérette bouffe, au titre parlant : Deux sous de charbon, ou le suicide de Bigorneau, une asphyxie lyrique. L’œuvre apparaîtra à l’affiche 14 années de suite. Offenbach remarque le jeune compositeur et l’invite aussitôt à collaborer avec lui dans son théâtre des Bouffes Parisiens où il donne, la même année 1856, deux autres opérettes, avec un grand succès. En 1861, Delibes écrit, pour la plus grande joie des spectateurs, avec Offenbach et d’autres confrères, une opérette, Les Musiciens de l’orchestre, parodie de la très populaire Muette de Portici, opéra mélodramatique d’Auber, son ancien directeur au Conservatoire. En 1857, il compose pour le Théâtre-Lyrique, où il est toujours accompagnateur, son premier opéra-comique, Maître Griffard. Il y donnera, en 6 1863, Le Jardinier et son seigneur. Cette même année, son activité de chef de chœur, lui offre l’occasion de travailler les partitions des Pêcheurs de perles de Bizet et des Troyens de Berlioz, pour leur création en ce lieu ; la même saison, pour une reprise, il arrange les parties vocales du Faust de Gounod. Certains musicologues vont jusqu’à prétendre que Delibes aurait écrit le ballet de Faust, indispensable pour que l’ouvrage soit créé, en 1869, à l’Opéra de Paris. Il est sûr que Gounod a essayé d’échapper à cette corvée en demandant l’aide de son ami Saint-Saëns qui déclina la proposition. Depuis 1858, Delibes fournit, au journal Le Gaulois, des critiques sous le pseudonyme d’Éloi Delbès, anagramme de ses nom et prénom. L’année 1865 est faste pour lui : pour le second voyage de Napoléon III en Algérie, Delibes écrit une cantate solennelle, pour soprano, chœur et orchestre, Alger, qui lui attire quelques faveurs impériales ; il réalise une parodie du Moïse de Rossini, intitulé Le Bœuf Apis, qu’il retire prudemment après la première représentation pour ne pas subir les foudres du « Cygne de Pesaro » qui fait alors la loi dans les salons et la vie culturelle de la capitale ; enfin, Delibes obtient le poste de deuxième chef de chœur à l’Opéra de Paris, sous la direction de Victor Massé. En 1867, il collabore avec Bizet et deux autres musiciens à l’opérette Malbrough s’en-va-t-en-guerre dont il écrit le quatrième acte. La qualité de ses orchestrations, dont il est redevable à l’enseignement de son maître Adam, paraît exceptionnelle comparée à ce que produisent ses confrères. Il s’en distingue d’autant plus, que rien dans ses partitions ne peut choquer le goût et l’attente des spectateurs. À défaut de style, il a trouvé un ton, dans la lignée de Boieldieu, Hérold et de son maître Adam : mélodies spirituelles, orchestre brillant, harmonies légères. Par ailleurs, l’organiste, qu’il est toujours, admire César Frank. Les ballets En 1866, Delibes signe la musique des deuxième et troisième tableaux du ballet La Source dont le compositeur austro-russe, Léon Minkus, écrit les première et quatrième parties. Le livret de Charles Nuitter et Arthur SaintLéon, comporte des éléments fantastiques et orientaux, très prisés à l’époque par le public parisien. Immédiatement, les pages écrites par Delibes attirent l’attention des musiciens et des ballettomanes qui décèlent chez lui des prédispositions pour le genre chorégraphique. Le critique de La France musicale oppose « la grâce et la langueur » de la musique de Minkus à celle de Delibes « plus fraîche, plus riche en rythmes et d’une orchestration plus recherchée. » L’engouement pour cette partition de 7 Delibes explique que, près de dix ans après, en janvier 1875, ce deuxième acte figure au programme inaugural de l’Opéra Garnier. En 1867, Delibes compose un divertissement, Le Jardin Animé à partir du ballet Le Corsaire de Joseph Mazilier et Adolphe Adam. En 1868, le compositeur reçoit la Médaille d’or de la Ville de Paris, pour deux œuvres chorales et en 1869, il donne sa dernière œuvre bouffe, La Cour du roi Pétaud, au Théâtre des Variétés. C’est désormais sur les traces de Meyerbeer, Bizet, Lalo qu’il s’engage. Mais c’est le triomphe du ballet Coppélia, ou La Fille aux yeux d’émail, joué à l’Opéra de Paris, le 2 mai 1870 qui lui vaut d’atteindre une célébrité durable. Il marque le retour au « ballet d’action », après le déclin du romantisme. Le sujet est tiré d’un conte fantastique d’E. T. A. Hoffmann, L’homme au sable. L’apparition de l’automate, l’utilisation des danses folkloriques marquèrent les esprits. De plus, l’histoire bien menée, montrant la lutte en chaque homme du bien et du mal, dépasse l’anecdote pour renvoyer à une réalité humaine profonde et indémodable. Cette œuvre inaugure également le genre du « ballet symphonique » : tout en étant au service de l’argument, la musique est également pensée pour le concert. Cette réussite est confirmée, en 1876, avec Sylvia ou la Nymphe de Diane, ballet dont l’action se déroule dans la Grèce antique. Le livret de Jules Barbier et du baron Reinach est complexe et a nui à sa postérité. Mais le critique de L’Opinion salue « une partition qui révèle la main d’un maître de la musique symphonique ». Piotr Illitch Tchaïkovski exprime son admiration pour Delibes, en particulier pour Sylvia : « Quel charme, quelle richesse mélodique ! […] Si je n’avais pas connu cette musique, je n’aurais jamais écrit Le Lac des cygnes. ». Il jugeait le compositeur français bien meilleur que Brahms, ce qu’il faut relativiser car il traitait le musicien allemand de « bâtard sans talent. ». Mais il considère Delibes comme le grand représentant de l’École française de ballet. Le Ménestrel du 18 juin 1876, fait chorus : « De tous nos compositeurs, M. Léo Delibes est aujourd’hui le plus essentiellement français. S’il voulait se montrer moins discret, il n’est pas douteux qu’il ne pût très promptement relever, avec le secours d’un ou deux confrères, la fortune compromise de notre Opéra-Comique. » Delibes a donné ses lettres de noblesse à la musique de ballet, jusque-là, considérée comme purement fonctionnelle, appartenant à un genre subalterne abandonné à des musiciens de second ordre. André Coquis, son biographe, affirme : « c’est bien probablement à Delibes que l’on doit la rénovation du ballet qui s’est produite au début du XXème siècle et qui a été l’occasion pour Debussy, Ravel, Roussel, Florent Schmitt et autres, de 8 composer des ouvrages qui comptent parmi les plus importants de leurs œuvres ». L’opéra Enfin reconnu, rassuré sur ses capacités musicales, Delibes se consacre entièrement, dès 1871, à la composition. Il quitte ses emplois d’organiste, et ceux de l’Opéra et fait un mariage avantageux avec Léontine Estelle Denain. Delibes reçoit la Légion d’Honneur en 1877, puis siège à la commission musicale chargée de l’organisation de l’Exposition Universelle de 1878. Il prend une forme de revanche avec le Conservatoire quand il y est nommé, en 1881, professeur de composition. En 1873, il revient à l’opéra-comique avec un sujet qui avait d’abord été proposé à Offenbach et dont l’action se situe à l’époque de Louis XIV, Le Roi l’a dit, sujet plein d’esprit et de grâce qui convient au tempérament du compositeur. Mélodies élégantes, expression juste et délicate, le tout est enlevé avec légèreté et allégresse et une qualité d’écriture pleine de trouvailles instrumentales. Cet opéra fut joué régulièrement jusqu’en 1900, plus rarement dans la première moitié du XXème siècle, avant de tomber dans l’oubli. Delibes crée en 1880, à l’Opéra-Comique, Jean de Nivelle dont il retrouvera les librettistes, Edmond Gondinet, Philippe Gille et le créateur du rôletitre, le ténor Jean-Alexandre Talazac, pour Lakmé. Le sujet historique, relève davantage du grand opéra à la Meyerbeer que du genre de l’opéracomique. Jouée jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’œuvre tombe ensuite aux oubliettes. En 1882, Delibes compose « six pièces de danse dans le style ancien », pour Le Roi s’amuse, de Victor Hugo dont Verdi a tiré, dès 1851, Rigoletto. Delibes se rend à Bayreuth la même année -celle de la création de Parsifal et sept mois avant le décès de Wagner-, au Festival de Bayreuth en compagnie d’Ernest Chausson, de Vincent d’Indy et de Camille Saint-Saëns. S’il reconnaît le génie du compositeur allemand, il ne cherche pas à s’en inspirer. Il confie au rédacteur du Télégraphe, en 1885 : « Pour ma part, je suis reconnaissant à Wagner des émotions très vives qu’il m’a fait ressentir, des enthousiasmes qu’il a soulevés en moi. Mais si, comme auditeur, j’ai voué au maître allemand une profonde admiration, je me refuse, comme producteur, à l’imiter. ». Il affirme à son ami Lalo qui l’incite à tirer profit de l’apport de Wagner : « Il est bien assez difficile de faire ma propre musique, et de tâcher qu’elle ne soit pas trop mauvaise. Si je me mettais à faire celle d’un autre, je suis certain qu’elle serait exécrable. » Ce qui plaide au moins en faveur de la sincérité du musicien et de sa probité. 9 UN RÊVE D’ORIENT Les Librettistes L’idée de Lakmé vient d’un collaborateur de Delibes qui a déjà écrit pour lui les livrets du Roi l’a dit et de Jean de Nivelle, Edmond Gondinet (1828-1888), fonctionnaire puis dramaturge français, auteur d’une quarantaine de pièces où il fait la satire du monde de l’administration. Il travailla notamment avec Eugène Labiche et Alphonse Daudet et, pour des livrets d’opérettes, avec les compositeurs Charles Lecoq, Robert Planquette et Hervé. Philippe Gille (1831-1901), librettiste d’opéra, tenait une chronique littéraire au Figaro, titrée « Bataille littéraire ». Gendre de Victor Massé, il a travaillé avec Eugène Labiche, Jacques Offenbach, Robert Planquette, Charles Lecocq et, avant Lakmé, avec Léo Delibes pour une demi-douzaine d’ouvrages dont Jean de Nivelle, en collaboration avec Edmond Gondinet. Gille signera le dernier livret du compositeur, Kassya. Son plus grand titre de gloire est d’avoir participé, avec Henri Meilhac, à la Manon de Massenet (1884). Il fut élu en 1899 à l’Académie des Beaux-arts. Le duo est en fait un trio, car Arnold Mortier (1843-1885), journaliste au Figaro, co-auteur du livret du Docteur Ox d’Offenbach avec Gille, participe à l’élaboration du livret mais refuse que son nom apparaisse. La presse se fait cependant l’écho de sa participation. Il a laissé lui-même quelques propos sur les rudes discussions concernant le livret, avec un Delibes qui traversait une crise de confiance en lui. Les sources Elles sont multiples et la première n’est pas d’ordre littéraire. Gondinet avait été fasciné, comme le public, par Marie Van Zandt (1858-1919), jeune cantatrice américaine d’origine hollandaise, « au physique de rêve, au charme étrange avec son visage chaste et provoquant, et sa voix au timbre de cristal hors du commun », aux dires des contemporains. Il la découvre comme les Parisiens, en 1880, dans le rôle de Philine, dans le célèbre opéra d’Ambroise Thomas, Mignon. À 21 ans, et en une soirée, elle avait mis Paris à ses pieds. Littéralement envoûté, Gondinet persuade son ami Delibes d’écrire un opéra pour cette soprano. Il lui parle d’un roman de l’officier de la Marine nationale, Julien Viaud, dit Pierre Loti, Rarahu ou le Mariage de Loti, paru en 1880 et plus ou moins autobiographique. Après ce grand succès, l’auteur se fera le chantre des amours éphémères et 10 douloureuses entre couples de races et de religions différentes : sa Madame Chrysanthème (1887) inspirera l’opéra éponyme d’André Messager (1893) et, indirectement, celui de Puccini, Madame Butterfly (1904). Delibes lit trois fois Rarahu, pendant un voyage qui le mène de Paris à Vienne. « Il y vit des danses étranges au clair de lune, des sonneries de fifres, des rêveries, d’amoureuses cantilènes, et, de la gare de Vienne même, il envoya à son fidèle ami Gille une dépêche pour lui dire que l’idée d’une idylle dans un pays lointain le transportait et qu’il ne voulait plus faire autre chose », raconte Mortier dans Les Soirées parisiennes. Les librettistes pensaient que le livre de Loti était difficile à adapter et voulaient en retenir « seulement la couleur, l’idée d’une passion sauvage aux prises avec notre civilisation européenne ». Ils trouvaient séduisant et émouvant le drame né du conflit entre la fidélité à une religion et à un pays et la puissance de l’amour. Or l’action se passe à Tahiti, loin de l’Inde. Depuis les années 1990, des recherches récentes ont exhumé une nouvelle, parue en 1849, dans la Revue des Deux Mondes, Les babouches du brahmane. L’auteur, Théodore Pavie (1811-1896), éminent orientaliste français, parlant chinois, hébreu, hindi et sanscrit, avait occupé la chaire de sanscrit au Collège de France, de 1853 à 1857. Il traduisit du sanscrit des fragments de l’épopée indienne du Mahâbhârata et du Ramayana. Il avait rapporté, de chacun de ses séjours en Amérique, Moyen-Orient, Inde, Chine, de nombreux textes et contes folkloriques. En 1839, il voyaga de Calcutta, à Madras et à Pondichéry. Il était en phase avec une France curieuse de la civilisation de l’Inde comme le prouve la traduction de la Bhagavad-Gita par Émile-Louis Burnouf, en 1861. Les Babouches raconte l’histoire d’un anglais, Sir Edward, qui mène une vie de dandy en Inde. Par bravade, il cherche à interrompre la méditation d’un brahmane, nommé Nilakantha, en lui posant ses babouches sur la tête. Pour cette profanation, ce dernier poursuivra l’insolent de sa vengeance implacable : la jeune épouse d’Edward meurt pour avoir respiré une fleur empoisonnée et lui se trouve bientôt réduit à l’état d’épave par une mystérieuse maladie. Mais il n’y a aucune intrigue amoureuse entre Roukmanie, la fille de quinze ans du brahmane, et l’Anglais. En revanche, la nouvelle décrit, avec un certain bonheur, les coutumes et les paysages du pays, présentés comme fascinants et inquiétants à la fois. L’atmosphère mystérieuse est propre à séduire des librettistes en quête d’un sujet d’opéra exotique. Indéniablement les librettistes se souviennent de certains éléments, comme le jardin du Brahmane décrit par Pavie et que reprend en termes identiques la didascalie du livret de l’opéra, pour décrire le décor du premier acte. Le couple d’Edward et de sa femme évoque celui de Gérald et 11 de sa fiancée Ellen. Lakmé comme Roukmanie se disent filles des dieux. Le brahmane manifeste une égale hostilité à la présence des Anglais dans les deux œuvres et il porte le même nom de Nilakantha. En revanche, celui de Lakmé est une invention des librettistes, sans doute inspiré par le nom donné aux épouses de Vichnou, Lakshmîs (Lakshmi au singulier), que cite Pavie. Mais les auteurs s’inspirent d’autres sources, notamment de livrets d’opéra dont les clichés poétiques, les schémas convenus de l’intrigue avaient eus du succès. Ils recomposent le tout pour l’adapter aux exigences de la répartition habituelle des numéros musicaux. Le tropisme oriental L’exotisme fait recette. Qui ne rêve depuis 1872 de faire Le Tour du monde en 80 jours ? Notons que les héros de Jules Vernes passent par les Indes où Passepartout et Phileas Fogg sauvent une jolie jeune femme indienne du bûcher, car on brûle les veuves avec le corps du défunt époux. Elle les accompagne jusqu’en Angleterre où elle épousera Phileas Fogg. Les explorateurs qui risquent leurs vies sont de vrais héros et ils font rêver, comme les contrées qu’ils découvrent. Les récits de voyages ou les romans inspirés par eux, comme ceux de Pierre Loti, sont des succès de librairie. Les éléments pittoresques, la couleur locale faussement réaliste, reflète plus la naïveté du temps que la réalité du pays décrit. L’actualité politique -les protectorats français sur la Tunisie et l’Annam datent de 1881 et 1883-, entretient la curiosité pout l’Orient qui remonte à des temps plus anciens. Ce qu’on appelle orientalisme en littérature, en peinture et en musique renvoie non pas à une référence géographique, historique ou stylistique précise, mais à une curiosité pour des terres et des civilisations lointaines. Le terme se répand à partir de 1830, mais cette tendance est bien antérieure : au XVIIème siècle apparaît la mode des turqueries dont témoigne le célèbre « mamamouchi » du Bourgeois Gentilhomme, comédie-ballet de Molière, musique de Lully. Sultanes et muftis de convention se multiplient au siècle suivant, qu’il s’agisse des sages orientaux qui peuples les romans des philosophes, des « turqueries » musicales de Mozart ou de la peinture galante de l’époque : la Pompadour se fait représenter en costume turc. Le XIXème siècle voit ce goût se développer avec l’« Égyptomanie » que provoque la campagne d’Égypte de Bonaparte de 1798, dans l’architecture, la décoration, la peinture. L’occupation de l’Espagne par les troupes de Napoléon entre 1808 et 1814 ramène l’attention vers le sud de l’Europe. C’est encore plus vrai avec le mouvement de libération nationale qui soulève les patriotes grecs contre l’autorité ottomane, en 1821. Les sanglants 12 massacres perpétrés par les Turcs, rallient à la cause grecque de nombreux étrangers qui, à l’instar de Byron, vont se battre aux côtés des insurgés. Cette guerre à peine terminée en 1830, commence la conquête de l’Algérie par la France. L’établissement progressif de colons français renforce l’intérêt et la curiosité pour les paysages et les coutumes du pays. Victor Hugo peut noter en 1829, dans la préface des Orientales, que « l’Orient est devenu une préoccupation générale ». Ce recueil offre un regard sur l’Orient méditerranéen, qui inspire de nombreux auteurs, peintres, décorateurs, et également compositeurs. Puis c’est vers un autre Orient, plus lointain et du même coup plus exotique, stimulant encore davantage leur inspiration, que se tourne toute une génération d’artistes. L’ouverture du canal de Suez, inauguré en 1869, le développement des routes, des voies ferrées et des liaisons maritimes à vapeur, favorisent les échanges et les voyages, élargissant la curiosité, jusque-là concentrée sur le pourtour méditerranéen, vers les horizons plus lointains de l’Asie, de la Polynésie. Les explorateurs sont souvent dans les pas des conquérants quand ils ne les précèdent pas. On s’intéresse autant aux paysages qu’aux types humains, aux coutumes, aux religions, aux langues. Il n’est pas besoin de courir les mers pour assouvir sa curiosité : les ouvrages, les gravures, les tableaux et les expositions universelles, où les grandes puissances comme la France et l’Angleterre peuvent exposer les richesses de leurs possessions lointaines, permettent de nourrir le rêve oriental, entre fascination et crainte. Cette place grandissante de l’Orient dans la conscience occidentale résulte également de l’écroulement des certitudes entraînées par la chute de l’Empire et l’affaiblissement de l’esprit des Lumières. Les précurseurs L’opéra ne pouvait échapper à ce tropisme. Témoins L’Enlèvement au sérail (1782), de Mozart, La Caravane du Caire, (1783), de Grétry, Le Calife de Bagdad de François-Adrien de Boieldieu (1800). Dès 1849, Ambroise Thomas, se souvenant de L’Italienne à Alger, écrit un opérabouffe, Le Caïd, dont l’action se déroule dans l’Algérie récemment conquise. C’est Félicien David (1810-1876) qui va fixer quelques règles d’écriture dans son ode-symphonie du Désert (1844). Au cours de son séjour en Égypte, ce musicien avait recueilli des mélodies arabes qu’il intègre à sa partition. Au-delà de l’exploitation d’un répertoire authentique, il élabore ce qui va devenir les formules idiomatiques de l’orientalisme musical, reprises tout au long du XIXème siècle par Saint-Saëns dans Samson et Dalila et par Léo Delibes dans Lakmé. Il s’agit du recours à 13 l’intervalle de seconde augmentée1 ; de l’introduction d’ostinatos rythmiques2 ; de l’utilisation du mode mineur. Félicien David consacre un opéra-comique, en 1851, à La Perle du Brésil dont l’air du mysoli (oiseau exotique) fait encore aujourd’hui le bonheur des sopranos légers, tandis que sa Lalla-Roukh, (1862) entraîne le spectateur sur les chemins de l’empire Moghol. Georges Bizet, en 1863, choisit le cadre de Ceylan pour ses Pêcheurs de perles. On y trouve déjà l’idée d’une prêtresse dont dépend la clémence des dieux et la profanation d’un lieu inviolable qu’il faut punir par la mort des criminels. La reine Selika, L’Africaine de Meyerbeer et Scribe (1865), amoureuse de Vasco de Gama qui repart vers l’Europe, choisit de mettre fin à ses jours en s’étendant sous un mancenillier aux effluves mortelles. Elle avait déjà protégé son amant du couteau d’un rival jaloux Nelusko. C’est un sacrilège qui met le héros en danger et elle le sauve en déclarant qu’il est son époux. Selika, comme Lakmé, soigne celui qu’elle aime, le berce en veillant son sommeil, et boit à la même coupe pour s’unir à lui. Le Roi de Lahore, opéra en cinq actes de Jules Massenet (1877) se passe dans l’Inde du XIème siècle. La prêtresse Sita aime d’un amour partagé, mais sacrilège, le roi Alim. Son rival le tue et contraint Sita à l’épouser. Mais lors du mariage, Alim réapparait, avec l’autorisation des dieux, dénonce le crime de l’époux. Les deux amants s’enfuient, Sita se tue et Alim meurt avec elle : tous deux montent au paradis des bienheureux. On mesure le scandale qu’a pu provoquer Carmen, deux ans plus tôt, par l’audace de son sujet et de sa musique, dans l’univers conventionnel de l’opéra-comique. Samson et Dalila (1877) de SaintSaëns, se passe dans la Palestine biblique et la veine orientale sera encore exploitée au début du XXème siècle (Henri Rabaud, Mârouf, savetier du Caire, 1914). On s’aperçoit que les librettistes de Lakmé reprennent des canevas déjà exploités. Quant à l’abandon d’une femme orientale par un Occidental sans scrupules, le thème relève également des topoï de la littérature orientaliste comme le rappelle Piotr Kaminski : il renouvelle le thème de l’amour impossible en remplaçant l’obstacle de la différence sociale par celui de la race et de la religion. Ce que l’on retrouve, en 1904, dans la Madame Butterfly de Puccini. Il est donc impossible de désigner une source unique d’inspiration pour le livret de Lakmé, il correspond à l’imaginaire d’un Orient lointain, propre à cette fin du XIXème siècle. 1 L’intervalle de seconde, habituellement d’un ton, do-ré par exemple, est élargi d’un demi-ton, do bémol-ré, donnant ainsi une couleur plus inhabituelle et du même coup plus exotique. 2 Répétition d’une cellule rythmique, procédé repris, plus tard, par Ravel dans Le Boléro. 14 LE REFLET DU TEMPS Le cadre colonial Lakmé se situe en Inde à l’époque de la colonisation britannique. Découvert par Vasco de Gama en 1498, ce territoire a très vite intéressé les Anglais qui, en 1600, fondent la Compagnie anglaise des Indes orientales. Quand la Compagnie française des Indes achète Pondichéry, en 1673, une rivalité de deux siècles s’installe entre Britanniques et Français. Elle se solde au profit des premiers : la Reine Victoria est couronnée Impératrice des Indes en 1876. Plus précisément l’action se déroule à une époque où s’est installé un climat de tension entre populations hindoues et colons britanniques, notamment pour des raisons religieuses, ce qui suscitent de nombreuses révoltes populaires. Si les librettistes Gondinet et Gille y font allusion, la politique n’est pas leur préoccupation première, pas plus que la vérité de la couleur locale, et les auteurs s’en tiennent à la vision sentimentale et attendrissante des récits de voyages, imaginaires ou non. L’intérêt d’un sujet exotique est de permettre aux compositeurs, librettistes et décorateurs, d’inventer des tableaux toujours plus imposants et étonnants, pour ravir le public parisien. L’authenticité ne compte pas, il ne s’agit pas de reconstituer les lieux avec exactitude, mais seulement d’évoquer quelque chose d’étranger, d’effrayant ou d’aventureux. Une esthétique de l’exotisme naît alors peu à peu, bousculant les principes de la juste mesure qui fondait l’art français jusquelà. Chaque nouvelle production théâtrale cherchera ainsi à rivaliser avec la précédente, en créant des décors toujours plus fastueux et surtout en visant un parallèle entre le sauvage et le raffiné, le colossal et le délicat. Il ne s’agit plus, comme pour les Romantiques, d’assouvir un besoin spirituel, mais d’opposer le modèle occidental à celui d’un univers perçu comme, plus ou moins, primitif. Les autochtones deviennent des ennemis : Mrs Bentson, la gouvernante de la fille du gouverneur anglais, les craint par-dessus tout. À l’opposé, Frédéric, l’officier ami de Gérald, incarne l’Occidental soucieux de respecter les coutumes locales. L’atmosphère est conflictuelle dès le début puisque les premiers propos entendus sont un appel du brahmane contre l’envahisseur étranger. L’histoire d’amour entre Lakmé et Gérald illustre cette opposition entre Orient et Occident. Cependant, Lakmé n’est pas un opéra militant mais d’abord le récit d’un amour interdit. Gérald n’est pas le lieutenant Pinkerton, celui qui conduira 15 Lakmé Affiche de la création au Théâtre national de l'Opéra-Comique. Lakmé - Le Duo du 3ème Acte Estampe d’Adrien Marie 16 Lakmé - Décor acte II Mady Mesplé, Lakmé (1970) 17 Cio-Cio-San, chez Puccini, au suicide. Mais le monde qui sépare Lakmé de l’officier anglais mène inéluctablement l’héroïne à la mort : malgré l’amour sincère qu’il lui porte, elle sait qu’il repartira. C’est un rêve, une folie3 qui doit prendre fin. Lakmé, entre opéra-comique et opéra Dans la lignée de l’opéra-comique traditionnel, Lakmé conserve le découpage en numéros, alternant airs et dialogues parlés et incluant également un divertissement dansé. Il existe deux versions de Lakmé qui témoignent des mutations subies par l’opéra-comique dans la deuxième moitié du XIXème siècle. À l’origine, Delibes compose une partition alternant passages chantés et parlés, ce qui est la norme à la Salle Favart, comme ce fut le cas pour Carmen. La plupart des dialogues, réservés aux Anglais et à Hadji, à l’exception d’une exclamation de Lakmé quand elle découvre Gérald blessé, ont peu à peu été remplacés par des récitatifs. À partir des années 1880, les dialogues parlés des opéras-comiques commencent à disparaître au profit de partitions intégralement chantées, comme c’est le cas pour Les Pêcheurs de Perles. Dans Manon, Massenet mêle quelques dialogues entre les parties chantées, le passage de l’un à l’autre se faisant par le recours au mélodrame, paroles sur un motif orchestral. Delibes conçoit donc des récitatifs chantés ou accompagnés appelés aussi ariosos : l’orchestre ponctue les interventions du chanteur dont les inflexions et la déclamation se rapprochent du parler. C’est ainsi qu’est traité l’éveil de Gerald à l’acte III, « Quel vague souvenir alourdit ma pensée ? ». Suivant les enregistrements, on peut entendre la scène où Hadji s’adresse à Lakmé au second acte, sous une forme parlée ou chantée, sur une mélodie à peine esquissée. La version avec ses dialogues originaux n’est plus jouée aujourd’hui. En cette fin du XIXème siècle, les opéras-comiques non seulement tendent à se confondre avec les opéras intégralement chantés, jusqu’alors réservés à la seule scène de l’Académie Royale de Musique, mais ils incluent un ballet au deuxième acte, spécifique des œuvres jouées à l’Opéra. Delibes ne se contente pas d’un bref divertissement, comme on en trouvait parfois à l’Opéra-Comique qui ne disposait pas d’un corps de ballet de grande qualité. En spécialiste du genre qu’il était devenu, il utilise son savoir-faire. Il convainc le public au point que le ballet du second acte de Lakmé sera repris lors du concert d’inauguration de la troisième salle Favart, le 7 décembre 1898. Lakmé emprunte encore au genre de l’opéra, la virtuosité 3 Gérald, acte II, scène 10. 18 vocale. Les rôles de Lakmé et Gerald nécessitent une grande agilité et une tessiture particulièrement étendue. Celle de Lakmé, qui affronte l’un des airs les plus virtuoses du répertoire, l’air des clochettes, au deuxième acte, s’étend sur plus de deux octaves. Le registre aigu de Gérald est particulièrement sollicité dans l’air de bravoure, Prendre le dessin d’un bijou. Par d’autres aspects, Lakmé relève de l’opéra-comique. Le quintette bouffe des Anglais, au premier acte, est typique du genre par son écriture et son entrain. L’Anglais ridicule fait depuis longtemps partie des personnages obligés des comédies à Paris, au XIXème siècle. À l’Opéra-Comique, le Milord du Fra Diavolo de Scribe et Auber, avait immortalisé, dès 1830, ce type dramatique. Cela correspond à un préjugé bien ancré chez les Français sur l’excentricité des Anglais, sujet inépuisable de moqueries, sans doute pour se venger de la « nation, ennemie héréditaire », depuis Jeanne d’Arc. Mais il y a aussi, dans cette scène de Lakmé, avec les cinq Anglais, le souvenir du quintette des contrebandiers à l’acte II de Carmen. Enfin, la forme couplets/refrains, utilisée à maintes reprises, est caractéristique de l’opéra-comique. Delibes y recourt dans les stances de Nilakantha au deuxième acte. Le refrain « C’est que Dieu de nous se retire, / C’est qu’il attend la mort du criminel. Mais je veux retrouver ton sourire, / Oui, je veux retrouver ton sourire, / Et dans tes yeux je veux revoir le ciel ! » s’intercale entre deux couplets. On retrouve cette structure dans la berceuse de Lakmé avec le refrain « le ciel tout étoilé / Le ramier blanc au loin s’en est allé », énoncé à trois reprises. Ce mélange d’éléments d’opéra et d’opéra-comique répond à une nécessité dramatique. La répétition, dans les deux cas, correspond à un moment où le personnage veut éloigner un danger (la malédiction des dieux, la mort de Gérald), c’est comme une idée obsédante qui revient sans cesse. Le compositeur attribue un type d’écriture à chaque personnage selon son caractère ou son origine : aux touristes anglais, la langue frivole et légère du quintette bouffe ; aux Hindous, la parole parlée ; aux personnages tragiques, le chant exclusif et la dignité du style. Lakmé ne recourt qu’une seule fois au parlé, quand elle crie « Hadji, ils l’ont tué ! ». Ce changement d’écriture souligne la spontanéité d’un personnage au comble de l’émotion. Dès sa première apparition, Lakmé chante dans un registre aigu accompagnée par un chœur grave d’hommes. Cette « hauteur » montre qu’elle est « fille des Dieux », au-dessus du commun des mortels. Sur le plan musical, Delibes ne s’aventure pas trop loin, se contentant d’agrémenter le discours musical de couleurs modales, de figures rythmiques plus souples, d’ornements et de vocalises qui contrastent avec le langage convenu des personnages anglais. Delibes utilise des instru19 ments évocateurs de l’Orient : le tambour de basque, tambourin serti de disques métalliques, dans la berceuse de Lakmé ; les crotales, sorte de petites cymbales, dans la section Terâna du ballet et surtout la flûte. Il privilégie certains intervalles comme les quintes à vide, intervalle de cinq notes sans tierce au milieu, et les secondes augmentées notamment dans l’ouverture et le ballet du deuxième acte. Enfin, les ostinatos rythmiques sont nombreux. Dans un souci dramatique, Delibes associe certains instruments à des personnages ; la harpe, aux arpèges aériens, accompagne les entrées de Lakmé tandis que le piccolo (petite flûte très aiguë) est associé à la comique et grotesque gouvernante Mistress Bentson. Le piccolo est aussi assimilé à la musique militaire. Au dernier acte, Gerald est tiraillé entre l’appel du devoir (les piccolos des fifres qui défilent au loin) et l’exotisme des gammes pentatoniques chantées par les couples hindous venus sceller leur union à la source sacrée. Dès les premières notes du prélude, la tension entre les deux univers musicaux est marqué. PAROLES ET MUSIQUE L’opéra s’ouvre sur un bref prélude fondé sur trois thèmes principaux qui ponctueront l’action et qui suggèrent l’ambiance orientale. Le premier, solennel, lié au brahmane Nilakantha correspond à l’invocation des dieux hindous. Il annonce le rôle joué par la religion dans le drame qui va se nouer. Le thème plus bref et plus allant qui se greffe sur lui annonce la scène du marché au second acte, là où se noue le drame à venir. Le second thème est celui de la prière de Lakmé qui installe une tonalité orientale, par sa courbe mélodique et par l’utilisation, notamment, de la seconde augmentée. Le troisième thème est celui de l’aveu amoureux de Gérald. Son côté élégiaque s’apparente au thème précédent par sa sensualité mais s’oppose fortement au premier. Ainsi, très habilement les trois personnages principaux, l’histoire d’amour impossible, la haine implacable, le cadre mystérieux sur fond de profanation religieuse sont mis en place. Acte I La première scène nous fait pénétrer dans un lieu sacré où le brahmane Nilakantha (baryton-basse), célèbre l’aurore dont l’apparition est suggérée par un ostinato de notes aiguës à la flûte, répétant un motif qui évoque la luxuriance de la nature indienne et l’aube naissante. Il ponctue l’incantation des hindous. Cette atmosphère sereine contraste avec les paroles du 20 prêtre qui prie les dieux d’abattre leur colère sur les colons anglais. Une mélopée en l’honneur de la « blanche Dourga », à la ligne mélodique onduleuse et mystérieuse par le recours au mélisme4, s’échappe de l’intérieur du temple. C’est la voix de Lakmé (soprano léger colorature), « la fille des dieux », que la musique nimbe d’une aura sacrée. Après le départ de son père, elle s’éloigne avec sa servante Mallika (mezzo-soprano) pour cueillir, le long de la rivière des fleurs de lotus bleu en l’honneur du dieu Ganesh. C’est le fameux duo des fleurs, Sous le dôme épais, dont le charme indéniable tient à son rythme berceur de barcarolle : les lignes vocales, dans l’aigu pour la soprano, dans le médium pour la mezzo, sont écrites à la tierce5 l’une de l’autre, ce qui donne une particulière douceur au chant. De plus, l’union des voix, délicatement soulignée par une orchestration subtile et un mélisme discret, crée un climat d’harmonie et de paix qui semble baigner ces lieux. En leur absence, deux officiers britanniques, Gérald (ténor) et Frédéric (baryton léger), accompagnés par la fille et la nièce du Gouverneur, Ellen et Rose, et leur gouvernante Mrs Bentson, pénètrent dans l’enceinte sacrée. Frédéric les met en garde contre les dangers encourus par la profanation qu’ils viennent de commettre, ce qui provoque les railleries de la petite troupe qui s’éloigne après une discussion sur les mérites de la femme européenne et indienne. Gérald reste seul pour Prendre le dessin d’un bijou, parmi ceux abandonnés par la prêtresse dont il se plaît à imaginer la beauté. Bien que de forme classique -un bref récitatif précède l’aria qui s’ouvre et se clôt sur la reprise de la même phrase, Fantaisie aux divins mensonges…, la mélodie exprime cependant l’émotion qui l’étreint : l’accompagnement essentiellement confié aux cordes présente un thème très lyrique, qui berce la rêverie d’où se détache le thème amoureux de Gérald déjà entendu, et la clarinette, exprime l’élan passionné de l’officier. Les voix des deux promeneuses se font entendre dans le lointain le forçant à se cacher. Lakmé restée seule se demande Pourquoi dans les grands bois…, toute la nature lui semble changée, la rendant triste et heureuse à la fois. Elle aperçoit Gérald. Effrayée et furieuse, elle veut d’abord le chasser, mais lui reste fasciné par elle comme s’il entrait de plein pied dans son rêve. Intriguée par la témérité de l’officier, elle veut connaître quel dieu le conduit. C’est le dieu de la jeunesse… C’est l’amour ! Cet hymne plein de flamme, à l’élan irrésistible, est bientôt repris à l’unisson par Lakmé. Mais l’approche de Nilakantha oblige Gérald à partir. Le brahmane, en découvrant la profanation des lieux, crie vengeance. 4 Ensemble de notes chantées sur une seule et même voyelle. Si le mélisme est vraiment long et développé on parle alors de vocalise. 5 C’est un intervalle entre deux notes que séparent trois degrés, do-mi, par exemple. 21 Acte II C’est jour de marché et un chœur de marchands et de matelots sur la place du village, s’interpellent. Surgit Mrs Benson égarée et effrayée par l’insistance des vendeurs, elle est bientôt rejointe par les autres britanniques. C’est une scène typique d’opéra-comique où un personnage ridicule se trouve en mauvaise posture. En même temps, une hostilité sourde, entre hindous et anglais, semble prête à éclater. Bientôt danseurs et bayadères viennent égayer les badauds. Ce ballet, très bien construit, fait partie des pages restées célèbres de l’œuvre. On entend comme une préfiguration des Danses Polovtsiennes du Prince Igor (1890) de Borodine, quand le chœur se mêle aux dernières danses. Alors que les cinq Britanniques se sont éloignés, Nilakantha, déguisé en mendiant, entre à la recherche de l’étranger qui a outragé sa fille. Celle-ci l’accompagne et essaie en vain de le faire renoncer à sa vengeance. Il lui explique sa démarche, en deux couplets élégiaques, rares chez lui, Lakmé, ton doux regard se voile…, dans lesquels le fanatisme du personnage le dispute à la tendresse pour sa fille : Dieu attend la mort du criminel. Il est persuadé qu’en faisant chanter Lakmé, l’officier qu’il cherche à identifier se trahira. Présentée comme une déesse incarnée, Lakmé consent à chanter la légende sacrée de la fille du paria. C’est le fameux air des clochettes, Où va la jeune hindoue… Les grandes capacités techniques de la créatrice du rôle, Marie Van Zandt, explique la grande virtuosité de cet air. Conscient que ses consœurs ne possèderaient pas les mêmes capacités vocales, Delibes a prévu dans sa partition deux lignes, au choix, l’une virtuose, l’autre beaucoup plus accessible pour celles qui prendraient la relève. Delibes compose ainsi un air dit « à roulades », en raison des nombreuses vocalises, destiné à combler un public toujours friand de prouesses vocales. Mais la virtuosité n’exclut nullement la musicalité. De plus, il a une justification dramatique : le chant doit être exceptionnel pour attirer l’attention du profanateur. La voix de Lakmé s’élève d’abord sans aucun accompagnement. La mélodie, qui tourne autour d’une même note, s’apparente à un chant d’oiseau. La première partie repose sur une longue phrase très legato, où figure la majorité du texte avec un accompagnement orchestral sobre utilisant essentiellement la harpe et la flûte, toutes deux traditionnellement liées à la féminité. Suit une sorte de transition, sur un thème de couleur très exotique : les percussions installent un rythme plus heurté, pendant que les bois exposent un motif mélodique ondulant, à la tonalité orientalisante. La dernière section est une immense vocalise extrêmement limpide et aérienne, entièrement écrite pour valoriser la ligne de chant, qui culmine sur un si 22 aigu, accompagnée du tintement des clochettes. Gérald arrive et la reconnaît. Lakmé troublée s’évanouit. Elle désigne ainsi son ennemi, à Nilakantha qui prévoit de le faire tuer le soir même, pendant la fête. C’est un lieu commun dramatique d’inscrire un événement tragique au sein d’un climat joyeux. Grâce à son fidèle serviteur Hadji, Lakmé, peut avertir Gérald du danger qu’il court et lui propose de la suivre dans la forêt où il sera à l’abri. C’est l’instant d’un échange passionné pendant lequel Lakmé avoue ses sentiments : Je ne veux pas que tu meures... Au nom de son honneur de soldat, Gerald refuse de fuir. Nilakantha survient et le poignarde, le laissant pour mort. Lakmé découvre qu’il n’est que blessé et ordonne à Hadji de l’emmener dans la forêt. Acte III Dans une cabane au fond de la forêt, Lakmé veille sur Gérald endormi mais hors de danger, en chantant une sorte de berceuse, d’une grande simplicité mélodique, comme murmurée mais qui révèle toute la force de son amour. Avec la deuxième strophe apparaît le tambour de basque qui rythme chaque nouvelle phrase de Lakmé, appuyant par son timbre exotique la sensation de chanson traditionnelle. Le contre-ut final, chanté pianissimo, ajoute à l’impression d’apaisement. Gérald s’éveille avec le sentiment de sortir d’un songe. Il invite Lakmé à l’y suivre : Ah ! vient dans cette paix profonde,… L’aile de l’amour a passé ! Il accepte de boire l’eau sacrée que va chercher Lakmé car elle assure un amour éternel et la protection des dieux. Pendant son absence, survient Frédéric qui a retrouvé la trace de son ami. Il le conjure de recouvrer sa raison, de rejoindre son régiment et sa fiancée. Gérald le promet. À son retour, Lakmé perçoit un changement. Alors que le son des fifres de la garde anglaise sonne au loin, -souvenir de Carmen ?- elle lui tend la coupe d’eau sacrée et se détourne pour mordre dans une fleur de datura à la sève mortelle. Elle lui dit une dernière fois son amour, Tu m’as donné le plus doux rêve… Tandis que Gérald boit le breuvage sacré et jure à Lakmé un amour éternel, Nilakantha surgit, et Lakmé mourante, lui révèle le lien sacré qui la lie à l’étranger. Lakmé expire, Gérald s’effondre, tandis que Nilakantha proclame, extasié : Elle est dans la splendeur des cieux. Avec Lakmé, Delibes parvient à trouver sa propre voie entre opéra à numéros (des sections hermétiquement séparées les unes des autres) et mélodie continue (aucune rupture de la mélodie). Cette position médiane lui attire les louanges d’un critique qui relève que certains éléments musicaux sont entendus à plusieurs moments dans l’opéra, comme le morceau des Fifres 23 ou certains thèmes liés à Lakmé. Les numéros sont ainsi perméables, sans que le procédé de citation atteigne au systématisme wagnérien qui agaçait le critique. En effet, lorsque Gérald prononce le nom de Lakmé, la mélodie du duo de l’acte I, Dôme épais…, réapparaît systématiquement. Le musicologue Rémy Campos dit que pour Delibes, « l’aventure de la création consiste chez lui autant à regarder en arrière qu’à risquer de sages nouveautés. » CRÉATION ET RÉCEPTION Deux chanteurs exceptionnels Lakmé obtient un triomphe le 14 avril 1883, à l’Opéra-Comique, deux ans après Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach et un an avant la Manon de Massenet. Dans l’assistance, on peut voir le compositeur Ambroise Thomas, l’écrivain Alexandre Dumas fils, l’ancien directeur de l’Opéra de Paris Emile Perrin et les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy. C’est Jules Danbé, resté célèbre pour avoir amélioré la qualité de l’orchestre de l’Opéra-Comique où il a créé les Contes d’Hoffmann en 1881, Manon en 1884 et Le Roi malgré lui de Chabrier en 1887, qui dirige. On n’a pas lésiné sur la splendeur des costumes et des décors luxuriants et colorés, qui ont coûté plus de quatre-vingt mille francs-or. Chaque acte a été confié à un décorateur différent. Cette beauté visuelle a contribué à la réussite de la soirée, ce qui ne diminue en rien la qualité des interprètes. La cantatrice américaine, Marie Van Zandt renouvelle son exploit réalisé dans Mignon. Les critiques ne tarissent pas d’éloges : « Cela n’a plus rien de terrestre, c’est une sorte d’apparition mystérieuse, une idole hindoue toute mignonne et éthérée, qui semble échappée du rêve d’un poète. » On admire la voix d’une extraordinaire agilité même si elle manque un peu de puissance, mais elle « donne avec Marie van Zandt, créatrice de Lakmé. facilité et douceur le mi suraigu »-, 24 comme les talents de la comédienne. Tout juste note-on l’accent texan dans les dialogues. On rapporte aussi qu’elle joue parfois les enfants gâtés, ce qui lui vaudra de se brouiller avec Léon Carvalho, directeur de l’OpéraComique, l’année suivante et elle ne chantera plus à Paris. Mais elle continuera sa brillante carrière et chantera Lakmé un peu partout dans le monde. Le ténor Jean-Alexandre Talazac (1853-1892) impressionne également et il est applaudi à tout rompre. Il a débuté en 1877 au Théâtre-Lyrique. Il a créé le rôle éponyme de Jean de Talazac, créateur de Gérald. Nivelle, en 1880, Hoffmann -son grand rôle d’Offenbach en 1881, le Des Grieux de Massenet, en 1884, et Mylio du Roi d’Ys, en 1888, Samson de Samson et Dalila en 1890. Son répertoire s’étendait de Mozart à Verdi (La Traviata). Il fit une carrière internationale : Lisbonne, Bruxelles, Londres, Monte-Carlo admirèrent son timbre clair et brillant, la chaleur et la puissance de sa belle voix qu’il savait ramener aux teintes les plus suaves de la mezza-voce. Il avait fait entrer dans la troupe de l’Opéra-Comique, son compatriote et ami d’enfance, Arthur Cobalet, avec lequel il chantera régulièrement. C’est lui qui crée le rôle du brahmane. La critique Malgré les esprits chagrins, Lakmé n’a pas vraiment quitté le répertoire en France, surtout en Province, même si dans les trente dernières années, on l’a vu plus rarement. On a tort de le réduire à son seul air des clochettes. La partition du ténor est une des plus belles jamais écrites pour une voix qui doit lier souplesse et vaillance dans l’aigu. Il y a surtout une parfaite adéquation entre les airs et la situation dramatique où ils sont développés. Les personnages sont joliment campés, même le bref rôle de Frédéric, dont on escamote trop souvent l’humour british. On goûte aujourd’hui encore la séduction de la grâce mélodique, l’élégance et le charme d’une orchestration habile, délicate et ravissante, souvent subtile. La fraîcheur de l’expression correspond à la sincérité des personnages. Si la forme reste 25 conventionnelle, elle est toujours liée à la situation dramatique. Par exemple, la couleur orientale n’est utilisée que dans les prières, les incantations, les danses et la scène du marché, donc là où c’est nécessaire. Elle n’a pas de fonction purement décorative. Il est incontestable que Delibes considère que sa responsabilité de musicien n’est pas de convaincre le public de son génie, au risque de le choquer ou d’être incompris par lui. Son devoir est, au contraire, de lui plaire en répondant à ses attentes. Ce qui n’implique aucune démagogie de sa part : seule la qualité d’écriture la plus soignée possible peut toucher la sensibilité de l’auditeur et l’éveiller à la beauté de la musique. Ce qui n’est pas une tâche simple. À propos de son ultime opéra, Kassya, Delibes confie à un interlocuteur anonyme : « Tout compte fait, c’est en prenant beaucoup de peine qu’on parvient à donner à la musique un ton aisé. La musique est comme une pâte qu’il faut tenir souple en la travaillant et en la réchauffant sans cesse, jusqu’à la mise au point la plus étudiée. » De plus, dans les années 1880, le public parisien de l’époque, légèrement frileux et peu réceptif aux innovations excessives, attend de l’école française qu’elle se distingue de l’école allemande et notamment du fantôme imposant que représente Wagner, par une certaine forme d’élégance, un sens du raffinement et surtout de l’équilibre. Ce qu’un critique a traduit par une formule lapidaire : « Delibes est Français, il boit dans son verre, laissant aux Allemands le plaisir de boire dans leur bock. » Un autre clôt le débat en éludant le problème : « Est-ce de la musique orientale ou de la musique française ? C’est de la musique charmante, voilà le principal. » Il y a quelques dissonances : on ironise sur « la colère tranquille et peu dangereuse » des Hindous quand Nilakantha les incite à la vengeance et sur cette Africaine « en miniature », ou sur cette « œuvre hybride, indécise, sans personnalité où se traduit presque à chaque page l’influence de Massenet ; œuvre pleine de romances trop souvent vulgaires, d’exotisme conventionnel et de fausse passion. » Willy, mari de l’écrivain Colette, très influent critique, se montre le plus catégorique en 1918 : « Lakmé a ranci. Les mignardises de cette musique avec l’âge, deviennent fatigantes comme les séniles minauderies de ces dames inquiétantes qui s’en vont répétant : « Vous ne pouvez pas vous figurer comme je suis restée jeune. » Les raisons d’un succès Pourtant, tous les ingrédients du succès, pour l’époque, sont réunis : exotisme, amours impossibles, musique délicate et colorée, airs qui se gravent aisément dans la mémoire, jusqu’à la caricature des Anglais (sauf Gérald 26 et Frédéric), dont les Français aiment tant se moquer. Autant de qualités qu’on a retournées contre le compositeur et l’œuvre. Certains lui ont reproché sa facilité mélodique, dont pourtant l’inspiration ne faiblit jamais, la vision simpliste, voire raciste, de l’Inde ! On s’en est pris à l’histoire, certes rebattue. Pourtant, elle retrouve une forme d’actualité puisque les conflits nés de l’opposition des cultures et des différences religieuses reprennent une regrettable actualité. Surtout, elle renferme tous les ingrédients des grandes histoires d’amour restées indémodables, comme celle de Tristan et Isolde ou de Roméo et Juliette : l’amour qui se heurte à un interdit social, religieux ou clanique, le filtre que l’on boit pour s’assurer un amour éternel (Juliette boit une drogue pour échapper au mariage qu’on veut lui imposer et pouvoir retrouver Roméo), la mort ou la séparation prématurée des amants. Cela ne suffirait pas sans la poésie du récit. En dehors de celui d’un exotisme suranné, a-t-on suffisamment remarqué que le personnage de Gérald évolue comme dans un rêve, d’un bout à l’autre de l’histoire, que Lakmé est d’abord une chimère, sortie tout droit de la contemplation des bijoux. Elle est plus un rêve désincarné qu’un être de chair. Quand Gérald reprend connaissance, après sa blessure, il se souvient de l’avoir vue dans une demi-conscience : loin de revenir à la vie réelle, il souhaite retourner, en compagnie de Lakmé, dans cet engourdissement bienheureux, « pour oublier le monde » et goûter « cette paix profonde ». La jeune femme a plus le sens des réalités. Elle aussi a fait « le plus doux rêve » mais « pour qu’il s’achève », elle doit quitter, seule, la vie. Gérald ne serait-il pas le plus exotique des deux ? A moins qu’il n’incarne le rêve d’un Occidental : s’approprier un Orient dont il ne voit pas la réalité et qui ne peut que lui échapper un jour. En 1950, Carmen était l’œuvre la plus fréquemment donnée à l’OpéraComique, suivie par Werther, Manon et Tosca. Lakmé était à la cinquième place pendant la première moitié du XXème siècle, devancée par La Bohème (1898), et Louise (1900). Lakmé est jouée en 1885, à Londres, par sa créatrice, Marie van Zandt. Bernard Shaw juge que Lakmé fut représenté non pour ses mérites mais pour sa convenance avec le talent de Marie van Zandt, ajoutant que c’était de la musique vraiment française, donc rien qui puisse intéresser un critique sérieux. Il fallut attendre 1910 et Luisa Tetrazzini pour que Lakmé soit donnée au Covent Garden, avant de disparaître du répertoire anglais. Même brève apparition aux États-Unis, jusqu’aux années 1930 et 40 où Lily Pons chanta 49 représentations sur 52 au Metropolitan Opera. L’opéra quitta ensuite l’affiche. Les créations tar27 dives à Vienne en 1904, à Buenos Aires en 1913, à la Scala en 1916, montrent que l’œuvre s’exporte mal, sauf artistes exceptionnels. Le rôle principal convient aux voix françaises d’où la limitation de ce répertoire à la France, comme pour Louise. La reconnaissance internationale Delibes a toujours été celle du compositeur de ballet. Delibes est élu à l’Institut, en 1884, au fauteuil de Victor Massé. Il publie en 1887 des mélodies, comme Les Filles de Cadix qui reste un air de bravoure pour les sopranos légers. Le 16 janvier 1891, il meurt, frappé d’une congestion. Il laisse un opéra inachevé, Kassya, terminé par Jules Massenet, et créé en 1899. Ce compositeur reste dans les mémoires comme un maître de la tradition musicale française, légère et mélodieuse. Il avait la réputation d’être un homme aimable. Il a construit son œuvre à son image. À LIRE Lakmé, L’Avant-Scène Opéra n°183, Paris, Editions Premières loges, 1998. COQUIS, André, Léo Delibes, sa vie et son œuvre (1836-1891), Paris : Richard Masse, 1957. KAMINSKI, Piotr, Mille et un opéras, Fayard, 2003. LACOMBE, Hervé Les Voies de l’opéra français au XIXème siècle, Paris, Fayard, 1997. PAVIE, Théodore, Scènes et récits des Pays d’outre-mer, Paris, Michel Lévy, 1853, p. 76-102. Accessible sur le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56200497.r=Pavie%2C+Th%C3 %A9odore.langFR À ÉCOUTER ET À VOIR Même si, dans la première moitié du XXème siècle, Lakmé est souvent programmé à l’Opéra-Comique, il n’y a aucun enregistrement intégral en français avant la version de 1952, chez Decca. On dispose jusque-là, dans les années 1920-30, d’airs isolés ou de duos, avec Miguel Villabella, Charles Friant, Georges Thill (Gérald), Germaine Feraldy, Solange Delmas, Yvonne Gall, et même Maria Callas (Lakmé), André Pernet, impressionnant Nilakantha. 28 Versions abrégées Elles ne sont guère plus nombreuses : Malibran a republié récemment une version, dirigée par Jésus Etcheverry, parfait connaisseur de l’opéra français avec Alain Vanzo, Renée Doria et Adrien Legros, parue chez Vega en 1961, bon exemple des distributions que l’on pouvait entendre à l’OpéraComique, diction et technique impeccables. EMI réunit, sous la baguette de Georges Prêtre, en 1962, Nicolas Gedda, Gérald racé, Gianna d’Angelo, Lakmé charmante, Ernest Blanc, magistral dans le rôle du brahmane. La réédition en CD se trouve dans un coffret EMI, Dix opéras français. Les années Pathé. On ne saurait oublier le couple canadien, à la ville comme au disque, formé par le grand mozartien Léopold Simoneau et Pierrette Alarie. Ils ont enregistré, en 1954, les airs et les duos des deux rôles principaux, avec Pierre Dervaux et André Jouve, republiés chez Philips. Tous deux sont de parfaits stylistes et font ressortir toute la délicatesse de l’écriture de Delibes. Intégrales en monophonie La première intégrale, réalisée en studio, est en fait en langue russe et date de 1946, avec la Lakmé de Nadezhda Kazantseva et l’impeccable Gérald de Sergei Lemeshev : une fois passé l’exotisme de la langue russe, on goûte une rare leçon de chant… français. Mais, en langue originale, la primeur revient à la version, de 1952, avec le chœur et l’orchestre de l’Opéra-Comique, republiée par Decca, à partir des matrices originales. Cette version est dirigée par Georges Sébastian (1903-1989). Ce chef d’orchestre d’origine hongroise, qui travailla avec Bruno Walter, établit d’entrée une tonalité de sombre grandeur et d’exotisme luxuriant, ce qui ne l’empêche pas de laisser percer l’humour des scènes avec les protagonistes anglais. Il sait donner vie et mouvement à l’ensemble. Le ténor suisse Libero de Luca, par ailleurs Werther, Des Grieux, Alfredo, ne rend pas le côté rêveur de Gérald et la voix a des raideurs déplaisantes. Jean Borthayre campe un Nikalantha orgueilleux et vengeur, au timbre chatoyant. À noter le (trop) suave Frédéric de Jacques Jansen, bien chantant mais qui manque un peu d’humour britannique. C’est la seule intégrale d’opéra officielle de Mado Robin. Le réalisateur, John Culshaw, qui devait produire, notamment, la Tétralogie de Wagner, dirigée par Georg Solti, ne se montre pas tendre avec la soprano dont il reconnaît l’étonnante étendue de la voix et la grande agilité mais dont il regrette l’absence d’expression. L’auteur de ces lignes, qui a entendu Mado Robin, à la fin des années 1950 sur scène, en garde un autre souvenir. D’abord celui d’une voix qui semblait jaillir sans 29 le moindre effort, même dans le registre le plus élevé et celui d’une artiste en empathie avec son public. Si bien que l’on oubliait qu’elle ne fut point une grande comédienne -s’en souciait-on à l’époque ?- mais elle imposait sa présence, faite de simplicité et de sincérité, ce qui allait droit au cœur du public et lui faisait croire à son personnage. S’agissant de Lakmé, il y avait une indéniable adéquation entre la pureté de son timbre, à la tonalité presque enfantine, et la jeunesse de son personnage et sa naïve et absolue loyauté. On retrouvait le sens original du terme chant, carmen, incantation magique qui faisait pénétrer l’auditeur dans un monde d’enchantement absolu, auquel n’étaient pas étrangers ses fameux contre-mi, contre-fa (de la Reine de la Nuit) et un ré au-dessus du contre-ré, aigus toujours harmonieux, d’une sonorité pleine et ronde, mais qui posaient des problèmes aux ingénieurs du son de l’époque. Pour ces auditeurs privilégiés, il y aura toujours celles qui chantent Lakmé, souvent excellemment, et celle qui était Lakmé, Mado Robin. Elle le vivait ainsi, comme elle le confessait, sans la moindre forfanterie : « Quand je chante Lakmé, je suis Lakmé de tout mon cœur, et quand elle meurt, j’ai vraiment la sensation de mourir avec elle. » On se risquera à suggérer que, peut-être, le fait qu’elle ait épousé, à 18 ans, un bel Anglais qui devait disparaître prématurément dans un accident de voiture, a contribué à renforcer cette identification. Mado Robin chanta Lakmé pour la première fois en 1946, à 28 ans, à l’Opéra-Comique. Elle devait participer, dans cette salle, à la 1500ème, le 29 décembre 1960, jour de son quarante-deuxième anniversaire, mais elle succomba le 10 décembre précédent à un cancer. La représentation, qui lui fut dédiée, eut lieu avec Mady Mesplé entourée par Alain Vanzo et Michel Roux. On a également publié, chez Rodolphe, une bande de radio de 1955, avec quelques coupures, avec une Mado Robin égale à elle-même, l’excellent brahmane de Pierre Savignol, et un Gérald Charles Richard, un peu frustre. La direction de Jules Gressier est inutilement brutale. On retrouve, en 1961 (Malibran), Savignol et Alain Vanzo, à son meilleur, avec Denise Boursin, qui a chanté Lakmé souvent, au timbre assez proche de celui de Robin, mais sans ses dons exceptionnels, tous dirigés par un Pierre-Michel Leconte très dynamique. L’intérêt est d’entendre le meilleur Gérald de sa génération, quelques années avant son intégrale en stéréo, enregistrée chez Decca en 1968. Versions stéréophoniques Dans cette dernière version, la Lakmé de Joan Sutherland est assez exotique pour des oreilles françaises : la voix n’a rien à voir avec celle d’une 30 très jeune fille et sa diction très relâchée ajoute au dépaysement. Reste la parfaite maîtrise de la technique vocale, même si l’air des clochettes est baissé d’un demi-ton. Les moments les plus élégiaques sont finement ciselés et elle se montre très vaillante dans les moments de forte tension. On est souvent plus du côté de Bellini que de Delibes. La voix d’Alain Vanzo a un peu perdu son côté juvénile mais elle a gardé ses accents charmeurs et la souplesse des demi-teintes. Gabriel Bacquier campe un Nilakantha, menaçant à souhait, il exprime plus l’autorité que l’inquiétude d’un père. Les aigus sont parfois un peu tendus, mais le personnage est crédible. Richard Bonynge, bon connaisseur de la musique française tire le maximum de l’orchestre de Monte-Carlo et, la stéréo aidant, fait rutiler toutes les couleurs et révèle les timbres les plus variés de la musique de Delibes. Quoi que l’on pense de cette version, il faut être reconnaissant à ce chef et à la Stupenda d’avoir défendu et fait triompher cet opéra en Amérique comme en Australie. On retrouve, en 1970, chez EMI, une distribution française avec Mady Mesplé, qui a longtemps chanté ce rôle. Elle a mûri le personnage, mais sa voix, elle le reconnaît elle-même, a des côtés métalliques qui passent parfois mal au disque. Charles Burles pâlit à côté de Vanzo, Roger Soyer est stylé, la voix est belle mais on ne croit pas un instant à son personnage. Alain lombard fait une lecture qui tend vers le grand opéra, ce qui alourdit parfois certains passages. Chez le même éditeur, en 1997, Natalie Dessay, qu’on a pu entendre à Nancy en 1996, grave une nouvelle version. C’est pour elle que l’Opéra-Comique a remonté Lakmé, longtemps délaissée, en 1995. On connaît les qualités d’interprétation de la soprano. Alors au début sa riche carrière, elle possède la voix du rôle qui se prête à toutes les inflexions qu’elle apporte à son personnages. Elle trouve en José Van Dam, un parfait alter ego : beauté du chant et incarnation d’un personnage fort mais blessé. Il donne une grande humanité à son Nilakantha, plus torturé qu’effrayant. L’américain Gregory Kunde a le style et la diction qui conviennent au rôle, un timbre assez séduisant, mais le chant semble précautionneux et manque de la fièvre qui ferait croire à sa passion. On connaît la probité musicale de Michel Plasson, à la tête de l’orchestre du Capitole de Toulouse, attentif à faire ressortir toutes les nuances de la musique, au risque de ralentir à l’excès le tempo. Notons dans le petit rôle d’Ellen, Patricia Petitbon et dans celui d’Hadji, Charles Burles ! Versions prises sur le vif Les versions live ne sont pas légion. Il faut signaler celle, historique avec la Française Lily Pons qui a imposé l’ouvrage au Metropolitan Opera (The 31 Golden Age). On en a un témoignage qui date de 1940, dirigé par Wilfrid Pelletier. Il faut passer sur la qualité technique d’une prise de radio de cette époque et accepter une conception de l’œuvre qui a évolué. Cependant Lily Pons se montre convaincante et le Nilakantha de Ezio Pinza est superbe. On trouve sous différentes étiquettes, Nuova Era notamment, la réalisation du Festival de Martina Franca (1991) avec Alessandra Ruffini, Giuseppe Morino, Bruno Pratico, sous la direction de Carlos Piantini. Le public semble beaucoup aimer, mais les accents sont à couper au couteau, le ténor a une curieuse émission de voix. Seul Nilakantha reste acceptable. Il ressort de toutes ces auditions que sans une grande Lakmé et un bon Gerald l’œuvre est dénaturée et perd son charme. Il est rare d’avoir ce couple parfait. Dommage que Mado Robin n’ait pas pu enregistrer avec Vanzo vers 1960. Il reste quatre grandes Lakmé : Mado Robin, Mady Mesplé, Joan Sutherland, Natalie Dessay. Le choix est large pour Nilakantha mais on regrette qu’Ernest Blanc n’ait pas fait l’intégrale. Quant à Gerald, Vanzo reste insurpassé par la séduction du timbre et l’art du chant. DVD Il a existé une version filmée à l’opéra de Sydney, avec Joan Sutherland en 1976, sous la direction de Richard Bonynge. Elle n’est plus disponible. En 2012 a paru, sous le label Opera Australia, tournée dans les mêmes lieux, une prise directe, avec Emma Matthews dans le rôle-titre, Aldo di Toro en Gérald, Stephen Bennett en Nilakantha, sous la direction d’Emmanuel-Joel Hornak, dans une mise en scène de Roger Hodgman. Le spectacle joue à fond sur la luxuriance des costumes et des décors. La soprano est connue par les retransmissions d’Opera Australia au cinéma. On a pu l’applaudir cette année dans La Traviata. L’ensemble se laisse voir et écouter agréablement. 32 Mado Robin Lakmé de Léo Delibes L’animation concernant la présentation de Lakmé aura lieu le samedi 16 novembre 2013 à 16 heures, salle Ambroise-Thomas de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole. Philippe Leider, conférencier, chef de chœur, spécialiste de Massenet, assurera la conférence. Entrée libre. Les représentations de l’opéra Lakmé auront lieu les vendredi 22 novembre 2013 à 20h, dimanche 24 novembre 2013 à 15h et mardi 26 septembre 2013 à 20h. Une demi-heure avant chaque représentation, un « amuse-bouche », brève présentation de l’œuvre, a lieu dans la salle Ambroise-Thomas. Entrée libre. Opéra-comique en actes en trois actes Livret d’Edmond Gondinet et Philippe Gille La distribution Nouvelle production de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole En coproduction avec le Theater Bonn Direction musicale : Jacques Mercier Scénographie Benoît : Dugardyn* Chorégraphie : Élodie Vella Mise en scène : Paul-Émile Fourny Costumes Giovanna : Fiorentini Lumières : Patrice Willaume Lakmé, Mélanie Boisvert* Gérald, Mirko Roschkowski* Hadji, Antoine Chenuet* Frédéric, Jean-Luc Ballestra* Rose, Pauline Claes* Nilakantha, Nicolas Cavallier Mallika, Carine Séchaye Ellen, Charlotte Dellion* Mistress, Benson Laure André Chœur et Ballet de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole Orchestre National de Lorraine * Pour la première fois à l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole Couverture : Directeurs de la publication : Fleur sacrée de lotus bleu Jean-Pierre Vidit, président et Danielle Pister, première vice-présidente Adresse postale du Cercle Lyrique de Metz : B.P. 90261 - 57006 Metz Cedex 1 Adresse du site : www.associationlyriquemetz.com Email : contact@associationlyrique.com Composition graphique et impression : Co.J.Fa. Metz tél. 03 87 69 04 90 info@cojfa.net.