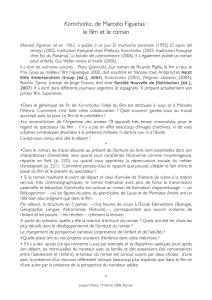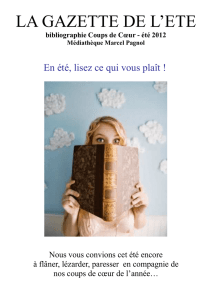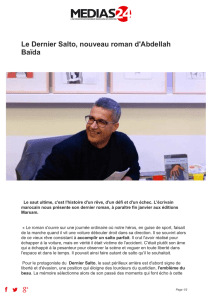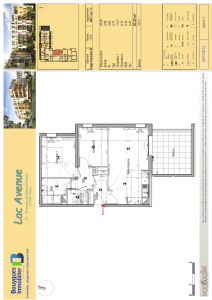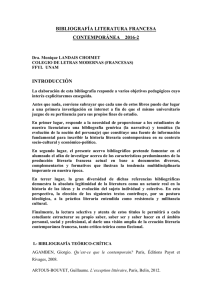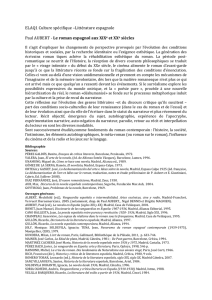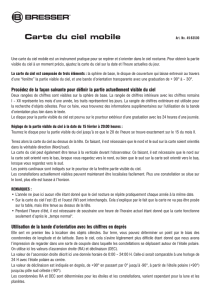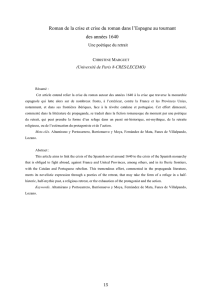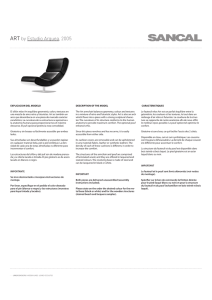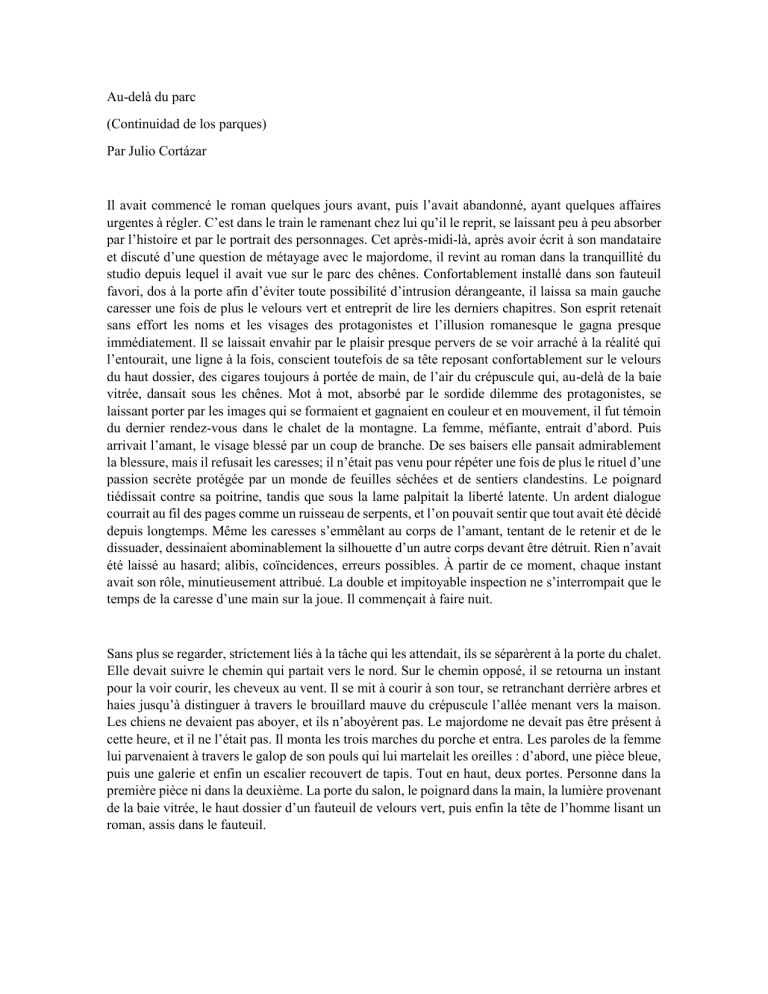
Au-delà du parc (Continuidad de los parques) Par Julio Cortázar Il avait commencé le roman quelques jours avant, puis l’avait abandonné, ayant quelques affaires urgentes à régler. C’est dans le train le ramenant chez lui qu’il le reprit, se laissant peu à peu absorber par l’histoire et par le portrait des personnages. Cet après-midi-là, après avoir écrit à son mandataire et discuté d’une question de métayage avec le majordome, il revint au roman dans la tranquillité du studio depuis lequel il avait vue sur le parc des chênes. Confortablement installé dans son fauteuil favori, dos à la porte afin d’éviter toute possibilité d’intrusion dérangeante, il laissa sa main gauche caresser une fois de plus le velours vert et entreprit de lire les derniers chapitres. Son esprit retenait sans effort les noms et les visages des protagonistes et l’illusion romanesque le gagna presque immédiatement. Il se laissait envahir par le plaisir presque pervers de se voir arraché à la réalité qui l’entourait, une ligne à la fois, conscient toutefois de sa tête reposant confortablement sur le velours du haut dossier, des cigares toujours à portée de main, de l’air du crépuscule qui, au-delà de la baie vitrée, dansait sous les chênes. Mot à mot, absorbé par le sordide dilemme des protagonistes, se laissant porter par les images qui se formaient et gagnaient en couleur et en mouvement, il fut témoin du dernier rendez-vous dans le chalet de la montagne. La femme, méfiante, entrait d’abord. Puis arrivait l’amant, le visage blessé par un coup de branche. De ses baisers elle pansait admirablement la blessure, mais il refusait les caresses; il n’était pas venu pour répéter une fois de plus le rituel d’une passion secrète protégée par un monde de feuilles séchées et de sentiers clandestins. Le poignard tiédissait contre sa poitrine, tandis que sous la lame palpitait la liberté latente. Un ardent dialogue courrait au fil des pages comme un ruisseau de serpents, et l’on pouvait sentir que tout avait été décidé depuis longtemps. Même les caresses s’emmêlant au corps de l’amant, tentant de le retenir et de le dissuader, dessinaient abominablement la silhouette d’un autre corps devant être détruit. Rien n’avait été laissé au hasard; alibis, coïncidences, erreurs possibles. À partir de ce moment, chaque instant avait son rôle, minutieusement attribué. La double et impitoyable inspection ne s’interrompait que le temps de la caresse d’une main sur la joue. Il commençait à faire nuit. Sans plus se regarder, strictement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte du chalet. Elle devait suivre le chemin qui partait vers le nord. Sur le chemin opposé, il se retourna un instant pour la voir courir, les cheveux au vent. Il se mit à courir à son tour, se retranchant derrière arbres et haies jusqu’à distinguer à travers le brouillard mauve du crépuscule l’allée menant vers la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer, et ils n’aboyèrent pas. Le majordome ne devait pas être présent à cette heure, et il ne l’était pas. Il monta les trois marches du porche et entra. Les paroles de la femme lui parvenaient à travers le galop de son pouls qui lui martelait les oreilles : d’abord, une pièce bleue, puis une galerie et enfin un escalier recouvert de tapis. Tout en haut, deux portes. Personne dans la première pièce ni dans la deuxième. La porte du salon, le poignard dans la main, la lumière provenant de la baie vitrée, le haut dossier d’un fauteuil de velours vert, puis enfin la tête de l’homme lisant un roman, assis dans le fauteuil.